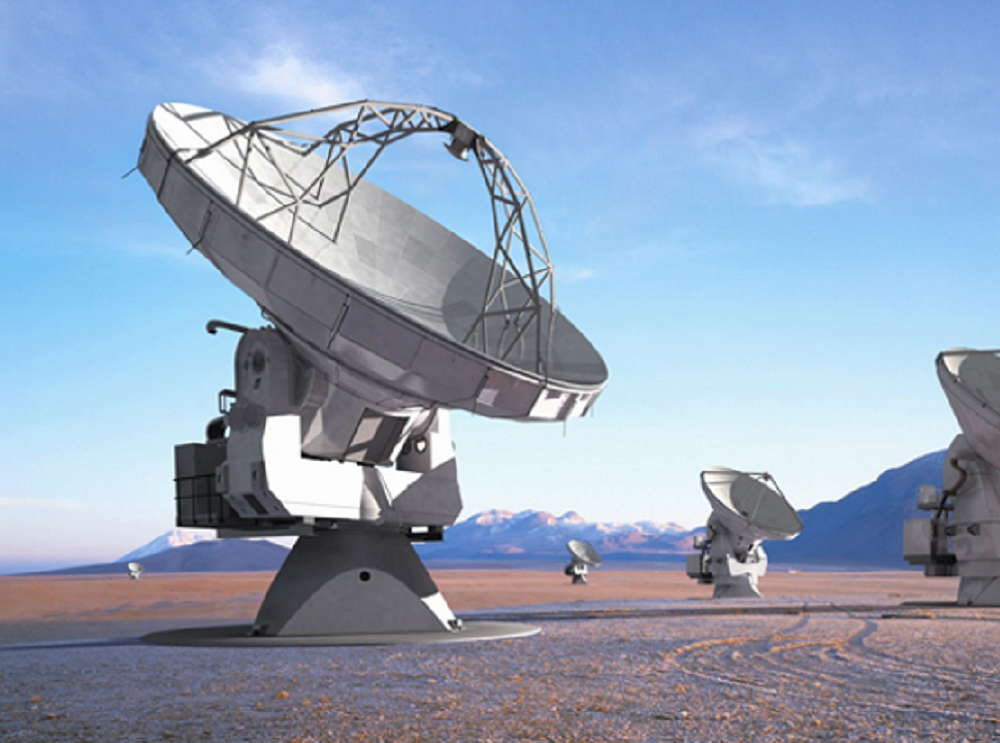Sans Soleil
Chris Marker, 1983
C’est un film de correspondances.
« Il m’écrivait… » dit une voix de femme. Elle lit les lettres de Sandor Krasna, un cameraman mu de par le monde qui lui conte les images prises au vol et leurs corrélations souterraines. Elle recompose à son tour les fragments, les souvenirs, récrit les rapports, trace des affinités. Ce florilège épistolaire, c’est la mémoire à l’œuvre; des images accolées en un constant colloque, un poème en mouvement qui conjugue les époques, et les lieux – le Cap-Vert, Bissao, le Japon, l’Île-de-France, étreints par le montage en un vaste archipel.
Sans Soleil se construit ainsi au fil d’évocations, de rebonds. Le film a pour exergue cette phrase de Racine, dans la seconde préface à Bajazet: “L’éloignement des pays répare en quelque sorte la trop grande proximité des temps.” La mémoire-montage entrelace les antipodes, réconcilie le rêve et la réalité, compose une « Zone » où se mêlent des notations ethnographiques, des mentions historiques et des pensées intimes, où l’observation ne cesse de croiser la confidence. Ces digressions trament une analogie entre le voyage, l’histoire et la mémoire, entre l’espace et le temps: l’image, le regard, la lutte, la méprise et l’oubli sont autant de motifs brodés à mesure par le va-et-vient de la navette. [1]
L’emblème de Sans Soleil pourrait donc être cette phrase, prononcée tandis qu’au gré de l’eau, du flot des lettres et des souvenirs, le montage assemble les rives du Fuji, les plages de Sal et d’autres ressacs, inconnus: « J’aurai passé ma vie à m’interroger sur la fonction du souvenir, qui n’est pas le contraire de l’oubli, plutôt son envers. On ne se souvient pas, on récrit la mémoire, comme on récrit l’histoire.«
Ce texte retrace les sauts et les sursauts de la mémoire, ses divagations d’un îlot à l’autre, et les ponts jetés entre ces berges.


« La première image dont il m’a parlé…«
Trois enfants blonds sous la brise, sur une route d’Islande. C’est une image parfaite du bonheur, dit la lettre, et plusieurs fois il a tenté de l’associer à d’autres images (celle d’un avion de chasse américain, pendant la guerre du Vietnam[2], par exemple), en vain. Il a le projet d’un film dont ces trois enfants seraient l’ouverture, suivis d’une longue amorce noire. “Si on n’a pas vu le bonheur dans l’image, au moins on verra le noir” explique-t-il à sa correspondante. A ce prélude succèdent le titre, un grondement sourd superposé à un haut-parleur et une série de visages endormis, dans un ferry japonais, que le narrateur compare aux fuyards d’une guerre passée ou future. Le bombardier, les exilés ensemble évoquent un désastre – dès lors ce noir où s’éteint l’image du bonheur, c’est la catastrophe à venir. (« Trains de nuit, fins d’alerte, abris atomiques. De petits fragments de guerre enchâssés dans la vie courante. ») La mémoire rejoint l’histoire, et s’y noie.
Ainsi les associations libres de la mémoire, du Japon à l’Afrique, au Sahel à la Guinée au Cap-vert, décalquent-elles une urgence historique, celle de la survie. « Mon perpétuel va-et-vient n’est pas une recherche des contrastes, c’est un voyage aux deux pôles de la survie« , écrit le cameraman. En Afrique, la sécheresse toujours recommencée, les corps fanés des bêtes, les lendemains de guérilla; au Japon, la guerre aussi, et les séismes, le sol qui se dérobe sous les rues et l’impermanence des choses.
Les raccords mettent aussi en jeu certains ricochets inexplicables de la mémoire. On file, à tire d’aile, d’un échassier africain aux berges franciliennes – “À propos saviez-vous qu’il y avait des émeus en Île-de-France ?” Cet étonnement en évoque d’autres, une fiancée des îles Bilago, un temple japonais dédié aux chats. Le film abonde de telles collures, dont certaines sont chargées de sens politique; les marginaux des rues de Tokyo vont droit aux tombes, un cimetière japonais mène à la jetée de Fogo, le recueillement à l’attente du départ, et les troupeaux décimés du Sahel ressuscitent en masques cornus, dans un carnaval bissao. « Sait-on jamais où se joue l’histoire ? »
Les lettres évoquent Sei Shônagon[3], dame d’honneur de la princesse Sadako au début du XIe siècle, qui avait la manie des listes. Liste des choses élégantes, désolantes, des choses qu’il ne vaut pas la peine de faire ou de celles qui font battre le cœur. Cet inventaire-là, le commentaire y revient souvent; la succession des images, le répertoire des souvenirs ne sont-ils pas, eux aussi, un catalogue d’émotions vécues ? « Ce n’est pas un mauvais critère, je m’en aperçois quand je filme« , écrit Krasna.
Ainsi, l’image retient ce qui fait battre le cœur. « Je salue le miracle économique, mais ce que j’ai envie de vous montrer, ce sont les fêtes de quartier« , dit une lettre du Japon. C’est une longue scène de danse, qui insiste sur le rythme des talons, des poignets, sur la pulsation entêtante du bayashi. La caméra peu à peu s’approche de la foule et s’y perd, est submergée de détails, étourdie de mains et de visages[4]. L’emballement du montage et des daikos redouble les transports de la mémoire; entre les musiciens japonais surgissent des rameurs africains, un émeu d’Île-de-France. Des sonorités électroniques gagnent peu à peu la bande-son, et les fêtes de quartier rejoignent la Zone, constellation de souvenirs.


C’est ensuite une série d’images de Tokyo, peuplées de lieux et d’animaux familiers, émaillées d’anecdotes choisies. La caméra se saisit de détails qui amusent, touchent, troublent l’opérateur, les chats et les chouettes surtout; la musique de la Zone résonne encore dans ces rues apprivoisées en « foyer« .
Les lettres égrènent quelques notes sur la vie urbaine, la caméra s’élève et surplombe. Krasna décrit la lecture effrénée, graphique, les visages peints aux murs, observant les voyeurs. À la nuit tombée la ville, veinée de trains de câbles, redevient une pléiade de villages; une toile de chantier retombe sur la forêt de grattes-ciel. Shakespeare et Godard bruissent aux tables d’un bistrot[5], et les gestes étudiés de monsieur Yamada, apte coloriste, peignent le mot « fin » sur la suite d’impressions.
Le lendemain, ou un autre jour, le cameraman est devant la télévision. La photographie d’un échassier lui évoque un poème ancien de Basho. Une émission sur Gérard de Nerval, et ses mots du tombeau de Rousseau mènent à un étang de l’Oise riflé de peupliers. Les films d’épouvante japonais résonnent des propos de Brando dans Apocalypse now. Les lettres fleurissent de références, et dans la « boîte à souvenirs » les images composent une anthologie en pied-de-nez aux siècles et aux lointains: « De Rousseau aux khmers rouges, coïncidence ou sens de l’histoire ? »
Les personnages du petit écran fixent à présent leurs yeux sur le spectateur indiscret. C’est là l’expression d’un voyeurisme tout japonais, décliné ensuite dans le rapport au sexe et au sacré, et d’une symbolique de l’œil chargée de superstitions. Et c’est aussi le prolongement d’une pensée du regard amorcée par Krasna dès la jetée de Fogo: « A-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l’enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra ? » L’égalité du regard, voilà le projet documentaire. Dans la foule des Cap-verdiens il retenait quelques œillades; des arrêts sur image restituaient le charme de ces instants fragiles, mais tenaces. Sur les marchés bissao, il essaie encore de filmer les dames, qui se détournent toujours – « apparemment, la fonction magique de l’œil jouait là contre moi. » Jusqu’à celle qui lui adresse enfin, trêve de badinage, un regard franc, le temps d’une seule prise, mais indélébile. L’image ira dans la Zone; un vingt-cinquième de seconde suffit à faire un souvenir.


Entre-temps justement, une digression sur les tremblements de terre s’appliquait, l’air de rien, au souvenir, et à ce qui en fait le prix: « La poésie naît de l’insécurité. [Les Japonais] ont pris l’habitude d’évoluer dans un monde d’apparences fragiles, fugaces, révocables« . Un monde à l’image de la mémoire, de ses îlots, des gouffres où elle s’absente; « Des trains qui volent de planète en planète, des samouraïs qui se battent dans un passé immuable. Cela s’appelle l’impermanence des choses. » Dans le ferry qui revenait d’Hokkaïdo déjà, après ce noir sinistre où se dissipait l’image du bonheur, ces ténèbres où rôdait la guerre aux côtés de l’oubli, la narratrice expliquait: « Il aimait la fragilité de ces instants suspendus, ces souvenirs qui n’avaient servi à rien qu’à laisser, justement, des souvenirs« .
Dans l’animisme japonais, expliquent les lettres, les choses sont « périssables et immortelles« , Comme les hommes dont les vies précaires s’éternisent en images, en souvenirs. Aussi c’est la même mélancolie digne, suppose Krasna, qui escortait le départ des poupées cassées et l’envol des kamikaze. La guerre, à nouveau, surgit au détour des plans; les pantins sont consumés par les flammes, au Japon, et en Guinée c’est une poupée blanche, aux mains d’une enfant noire, qui ravive les espoirs d’Amilcar Cabral, et les plaies vives de l’indépendance. Sur l’envers des images, l’oubli: « Qui se souvient de tout ça ? L’histoire jette ses bouteilles vides par les fenêtres. » La mémoire enregistre pour son compte: voilà des chats, et les musiques électroniques de la Zone.
En Guinée-Bissau les statues sont à terre, brisées; au Japon elles s’érigent en hommage aux animaux fidèles, et un jour disent les lettres il y aura sur la place où sa voix orageuse fait frémir les drapeaux l’effigie sévère de monsieur Akao, chantre de l’extrême-droite fiché dans le paysage urbain, Il est question des luttes, de l’héroïsme défait, du terrain cédé à l’impérialisme dont les fantoches s’agitent dans les grands magasins, d’illusions perdues. « Rien n’est simple« , dit la narratrice. À Narita où des adolescents casqués combattaient vingt ans plus tôt la construction d’un aéroport, on assiège l’aéroport qui s’est construit quand même. Le présent rejoue le passé, constatent les lettres, sans surcroît d’amertume. Un ami de Krasna se propose de les distinguer en traitant les archives au synthétiseur: c’est des silhouettes vives, tout à la fois méconnaissables et terriblement expressives, qui ne se donnent pas pour une capture exacte de la réalité, mais pour ce qu’elles sont, des images, des souvenirs, et qu’il appelle « la Zone » en hommage au Stalker de Tarkovsky. C’est des images revues, recolorées, des branchements singuliers détournant le signal collectif – la Zone, c’est la mémoire.
Sans soleil porte un regard sans indulgence ni reniement, lucide simplement, sur les luttes échouées des années soixante. Des paysans sont entrés en prise avec le monde, des étudiants se sont entre-tués, ont rêvé au martyr, d’autres ont mis au service du capitalisme les armes fourbues contre lui. La lutte était un cri nécessaire, généreux, que les lâches ou les oublieux étouffaient alors dans leur gorge, mais son mot d’ordre était un mirage: « Unir dans la même lutte ceux qui se révoltent contre la misère et ceux qui se révoltent contre la richesse. » Le Japon et l’Afrique, l’excès et le manque – aux deux pôles de la survie, des antipodes définitifs.


Les lettres racontent un rêve récurrent qui a pour décor les souterrains de Tokyo, un dédale sous la ville. C’est une image fuyante, le fragment peut-être d’un songe partagé où conspirent les dormeurs du métro. Ces bribes recomposées font un film, « le film absolu« , la mémoire collective. Pareil à un défilement de pellicule, le voyage en train figure le trajet du souvenir, le long des rails solarisés et revus par la Zone, pour rejaillir sous les paupières closes – les images de la télévision, l’horreur et l’érotisme, s’immiscent soudain entre les visages assoupis.
Les images font retour, obsèdent, elle se heurtent et s’éclairent au gré du montage. Le sens est sans cesse recomposé, dans la « liste des choses qui font battre le cœur« : images, survie, souvenir, lutte pour la survie, souvenir d’images de luttes, survie des images, des luttes, et du souvenir. Sans Soleil est un film musical, dont la structure est élucidée par cette phrase de Krasna, à propos du Japon-partition: « Tout cela s’emboîtait comme les voix d’une fugue un peu compliquée, mais il suffisait d’en prendre une, et de ne pas la lâcher. Celle des écrans de télé par exemple. À eux seuls, ils dessinaient un itinéraire qui se refermait quelquefois en boucles inattendues. »
Cette clef livrée sans y penser les lettres prolongent en sociologie leur digression musicale. et s’attardent sur les jeux vidéos, manie japonaise, paraboles politiques dont les refrains entêtants permettent de « jouer de mémoire« . L’artisan de la Zone, Hayao Yamaneko, crée des jeux lui aussi, qu’il peuple volontiers de chats et de chouettes pour plaire à son ami. « Il prétend que la matière électronique est la seule qui puisse traiter le sentiment, la mémoire, et l’imagination. » Que pour représenter des marginaux, des non-hommes, il faut des non-images. Sans Soleil fait de cette intuition son projet, et ses images altérées figurent la mémoire comme un non-lieu, affranchi de l’espace; un non-temps, où se fondent les époques. L’enjeu du vingtième siècle, disaient les lettres plus tôt, c’est « la cohabitation des temps.«
La religion japonaise s’accommode déjà de cette constante mêlée de l’actualité et du passé, où « la cloison qui sépare la vie de la mort ne paraît pas aussi épaisse qu’à un Occidental« . En Guinée, sur l’archipel des Bijago, la mort n’est pas un écran mais un chemin qui va d’île en île, jusqu’au dernier rivage. Amilcar Cabral, en noir et blanc, salue cette plage qu’il ne reverra plus, et quinze ans plus tard, son demi-frère Luìs à présent président fait le même geste, en couleur. La mort et l’histoire suivent le même trajet. (La mémoire tient ensemble les deux itinéraires: traversée de la cloison, ou du miroir, quand les images rejoignent la Zone; sauts d’un îlot à l’autre, dans le vaste archipel des souvenirs.)
Les archives de la guérilla, dont les lettres racontent les horreurs et la victoire, trouvent un nouvel écho au présent – l’embrassade du chef aux combattants, en noir et blanc d’époque puis en couleur, le 17 février 1980. La narratrice superpose encore l’avenir à ces temps mêlés: Luìs Cabral, un an plus tard, sera renversé par un coup d’état ourdi par l’officier qu’il décore. La cérémonie était dédiée à la mémoire collective, mais les hommes étaient seuls avec leur mémoire blessée. L’histoire, les mémoires déchirées garderont longtemps leurs cicatrices; les soldats mutinés découvriront à leur tour des complots tramés contre eux. L’histoire se répète, ses révolutions tournent en boucle, mais tendue simplement vers l’avenir elle refoule son passé dans l’oubli, le déni, et « se bouche la mémoire« .


La mémoire c’est la spirale: la hantise des images, pour chacun, et le retour des rites pour tous. L’histoire, elle, se rêve en ligne droite. Voilà pourquoi elles sont, l’une pour l’autre, « une impossibilité. » L’histoire est amnésique, toujours; ceux qui la font et ne songent qu’à demain ne peuvent en déchiffrer les rengaines, tout comme celui qui examine sa mémoire se perd, forcément, en divagations. « Les mémoires doivent se contenter de leur délire, de leur dérive. Un instant arrêté grillerait comme l’image d’un film bloqué devant la fournaise du projecteur. […] J’envie Hayao et sa Zone. Il joue avec les signes de sa mémoire. Il les épingle et les décore comme des insectes qui se seraient envolés du temps, et qu’il pourrait contempler d’un point situé à l’extérieur du temps, la seule éternité qui nous reste. Je regarde ces machines. Je pense à un monde où chaque mémoire pourrait créer sa propre légende. » Faire entrer les images dans la Zone, dans le film, s’en défaire, interposer entre soi et sa mémoire des lettres et des écrans, voilà comment.
Un film, déjà, a su dire la mémoire et sa fièvre: Vertigo. La narratrice conte le pèlerinage de Sandor Krasna sur les lieux de tournage d’une œuvre qui le fascine. Il pense que le vertige qui s’empare de Scottie n’est pas celui de l’espace, mais bien celui du temps, figuré par cette spirale inscrite dans l’œil et le chignon de Madeleine. Sans Soleil reproduit cet égarement en superposant la coupe de séquoia de Vertigo, et Kim Novak indiquant les années dans les cernes du bois, et cette autre coupe dont se souviennent les lettres, dans un autre film, dont le héros montrait à côté de l’arbre un point à l’extérieur du temps – La Jetée, du même Chris Marker, où déjà l’on tentait de déchiffrer la mémoire pour s’évader de la guerre, où déjà le sésame était une image d’enfance, une image paisible.
Et les lettres d’imaginer, parti d’Islande, un autre film encore, l’envers des autres, où le drame ne serait plus l’amnésie mais le souvenir. L’histoire d’un homme du quarantième siècle, dont la mémoire infaillible s’indigne et s’émeut qu’on put, à une époque reculée, frémir sans le comprendre devant un portrait[6], ou trembler à l’écoute d’une ancienne mélodie. Lui qui ne connaît pas l’oubli n’a pressenti qu’une fois cette corrélation secrète entre le malheur et la mémoire, dans quelques notes de Mussorgsky dont le sens s’est perdu. Ce film, disent les lettres, ce film impensable sur les tréfonds du souvenir et sur les coupes du temps, ce film ne se fera pas, bien sûr, mais il a déjà des images, et un titre, celui du morceau de Mussorgsky réarrangé, revu par les mêmes couleurs électroniques que les images de la Zone, revu par la mémoire: Sans Soleil.
« La folie protège« . Pour se déprendre des souvenirs, il faut en faire fiction, les recomposer. Il faut admettre que les images ne sont que des vestiges[7], et qu’hors-cadre, rien n’est plus. Car l’oubli consume.


On revient au Japon. Il est question encore des fractures de l’histoire, des images de la guerre figurées dans la Zone comme des lettres qu’on brûle. Puis c’est des rebonds, encore, au gré des souvenirs; sur l’île de Sal passés les morts, un désert, et surgissant dans ce rien, le trop, les rues de Tokyo superposées soudain aux horizons arides. Mirages de la mémoire: « J’ai compris les visions. Tout d’un coup, on est dans le désert comme dans la nuit. Tout ce qui n’est pas lui n’existe plus. Les images qui se proposent, on ne veut pas les croire. » Des variations électroniques dansent sur les émeus d’Île-de-France. Une tour en ruines, à Montepilloy, évoque le phare de Sal. Les chiens errants qui jouent dans les vagues ramènent au Japon, où l’on fête le nouvel an lunaire, et le signe du chien croisant celui de l’eau. Le souvenir et l’image se confondent[8] et le film remplace la mémoire, « qui va de relai en relai, […] et que le souvenir d’une couleur précise dans la rue fait rebondir sur un autre pays, sur une autre distance, sur une autre musique, à n’en plus finir. » Peu à peu à force d’enregistrer, avant le quarantième siècle et sa mémoire totale, on oubliera la nostalgie.
À vingt ans les Japonaises entrent dans l’âge adulte; le secret de l’enfance doucement s’étiolera, mais elles sont gaies. Au pays du soleil levant, l’oubli mérite hommage, et l’on brûle en janvier les débris de l’année écoulée; c’est le dondo-yaki,“le dernier état, avant leur disparition, de la poignance des choses. Il faut que l’abandon soit une fête, que le déchirement soit une fête, que l’adieu à tout ce que l’on a perdu, cassé, usé, s’ennoblisse d’une cérémonie.” Les enfants font la ronde autour du bûcher, et dans la fumée reparaissent les trois têtes blondes, sous la brise, sur une petite route d’Islande. Cette fois le plan va jusqu’au bout, les enfants s’éloignent battus par le vent et la caméra tremble avec la main qui la porte; une fragilité qui dit finalement, « mieux que le reste« , pourquoi il a tenu cet instant à bout de bras, jusqu’à son dernier vingt-cinquième de seconde. Les lettres dévoilent, derrière l’image, le désir profond du filmeur: conquérir, par le regard, une fraction du temps bientôt englouti.
“Lorsque cinq ans après Haroun Tazieff m’a envoyé ce qu’il venait de tourner au même endroit, il ne me manquait que le nom pour apprendre que la nature fait ses propres dondo-yaki. Le volcan de l’île s’était réveillé. J’ai regardé ces images, et c’était comme si toute l’année ’65 venait de se recouvrir de cendres. La planète mettait elle-même en scène le travail du temps.” Il n’y a plus qu’une image qui émerge du noir[9]; le noir c’était la catastrophe, l’oubli de tout le reste et l’exil du souvenir, arraché à l’Islande et à ce jour de bourrasques. Un chat, dans la ville ensevelie, rappelle la prière que ce couple de Japonais adressait à leur animal disparu, par-delà les accrocs du temps: « Chatte aimée, où que tu sois, repose en paix. »
Les images aimées, d’où qu’elles viennent, de quel rivage de quel archipel elles dérivent, reposent dans la Zone. Les fêtes de quartiers, les kimonos d’hiver, le regard de la dame du marché de Praia, qui ne durait qu’un vingt-cinquième de seconde. “Je descendais dans la cave où mon copain le maniaque s’active devant ses graffitis électroniques. Au fond, son langage me touche parce qu’il s’adresse à cette part de nous qui s’obstine à dessiner des profils sur les murs des prisons. Une craie à suivre les contours de ce qui n’est pas, ou plus, ou pas encore. Une écriture dont chacun se servira pour composer sa propre liste des choses qui font battre le cœur, pour l’offrir ou pour l’effacer. A ce moment là la poésie sera faite par tous, et il y aura des émeus dans la Zone.”
C’est un film d’évocations, un film-spirale. Un film du temps perdu, autrement retrouvé, qui expose sa recherche, sauve les souvenirs qui peuvent l’être, bénit les oublis et boucle sur une image d’enfance, sur le secret: la mémoire heureuse.
[1] C’est Marker lui-même qui suggère cette analogie, dans la séquence du temple des chats: « Il fallait donc qu’ils viennent là tous les deux, sous la pluie, accomplir le rite qui allait réparer, à l’endroit de l’accroc, le tissu du temps.«
[2] Ce plan, tiré de Loin du Vietnam dont Marker fut monteur en 1967, et qui ouvrait une première période, engagée, de son oeuvre, figure ici une « remise au fourreau » (Arnaud Lambert, Also known as Chris Marker, Paris, Le Point du jour, 2013, p.135) symbolique: après Le Fond de l’air est rouge, Sans Soleil marque un tournant, où la mémoire prend la relève de la lutte.
[3] Sei Shônagon est déjà citée par Nicolas Bouvier dans sa Chronique japonaise, un texte qui accompagna les premiers voyages de Chris Marker dans l’archipel nippon.
[4] La succession des visages de femmes rappelle l’ouverture de Cinq femmes autour d’Utamaro, réalisé en 1946 par Kenji Mizoguchi. Marker cite le peintre et le cinéaste japonais plus loin dans Sans Soleil.
[5] Ce petit bar de Shinjuku s’appelle « La Jetée ». Aux murs il y a des images du film éponyme de Chris Marker, et c’est là qu’en 1985 Wim Wenders fit dans Tokyo-Ga un portrait fugace du cinéaste.
[6] Dans Immemory, Chris Marker rapproche Vertigo du projet proustien autour de la question « Qu’est-ce qu’une Madeleine ?« , et écrit « Il est banal de dire que la mémoire est menteuse, il est plus intéressant de voir dans ce mensonge une forme de protection naturelle qu’on peut gouverner et modeler. Quelquefois, cela s’appelle de l’art. » Comme sa mémoire est totale, donc « anesthésiée« , l’homme du quarantième siècle ne peut plus ressentir de nostalgie, il ne connaît pas les joies navrées du manque et de la remémoration. L’art, suggère Marker, et les émotions qu’il suscite ne sont qu’affaires de mémoire.
[7] Dans La Jetée déjà le narrateur disait: « Rien ne distingue le souvenir des autres moments; ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leur cicatrice.«
[8] Chez Chris Marker, les mécanismes de la mémoire se calquent sur les techniques photographiques. En ouverture du Tombeau d’Alexandre, il plaçait cette citation de George Steiner: « Ce n’est pas le passé qui nous domine. Ce sont les images du passé. » Le souvenir, dès lors, ne tient plus qu’au cinéma, ce dont le cinéaste quelque peu s’inquiète: « Je me souviens de ce mois de janvier à Tokyo ou plutôt je me souviens des images que j’ai filmées au mois de janvier à Tokyo. Elles se sont substituées maintenant à ma mémoire, elles sont ma mémoire. Je me demande comment se souviennent les gens qui ne filment pas, qui ne photographient pas, qui ne magnétoscopent pas. Comment faisait l’humanité pour se souvenir ? Je sais, elle écrivait la Bible. La Nouvelle bible ce sera l’éternelle borne magnétique d’un temps qui devra sans cesse se relire pour seulement savoir qu’il a existé. »
[9] On pense alors aux mots de Proust que Chris Marker citera en introduction à Immemory, en 1997: « Mais quand d’un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seules, plus fidèles, l’odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer, sur la ruine de tout le reste, à porter sans flêchir, sur leur goutelette presque impalpable, l’édifice immense du souvenir. » – Marcel Proust, Du côté de chez Swann, Paris, Gallimard, Folio Classique, 1924, p.104
À lire aussi, l’éloquente synthèse d’Ignacio Ramonet dans Le monde diplomatique, et Sans Soleil, analyse d’une poétique de la mémoire de Nabil Hammoud.
à lire aussi sur Kopfkino: